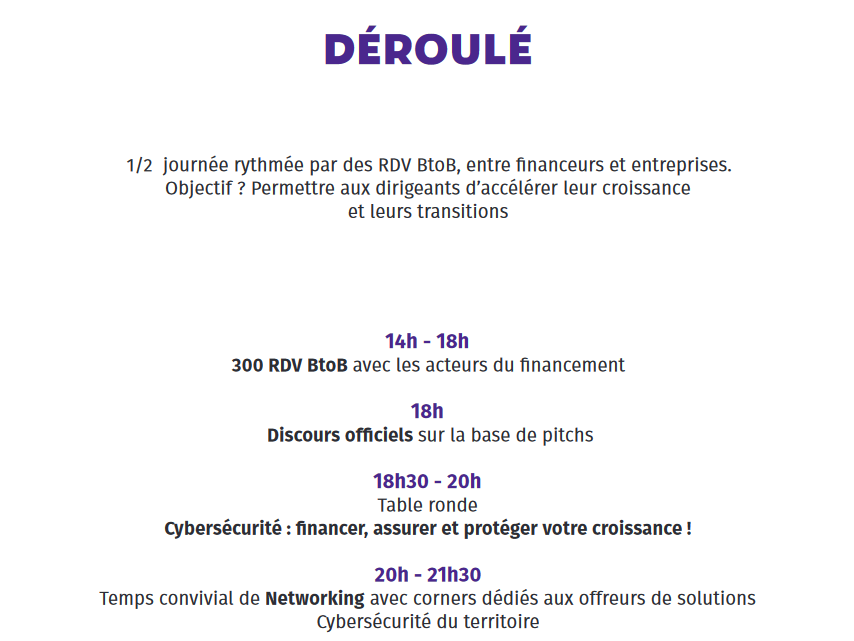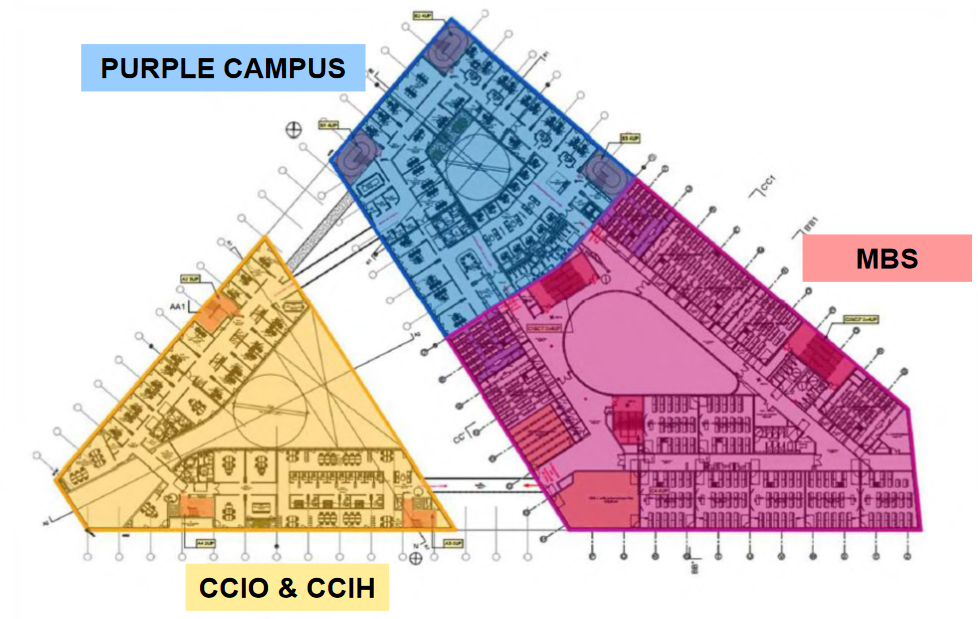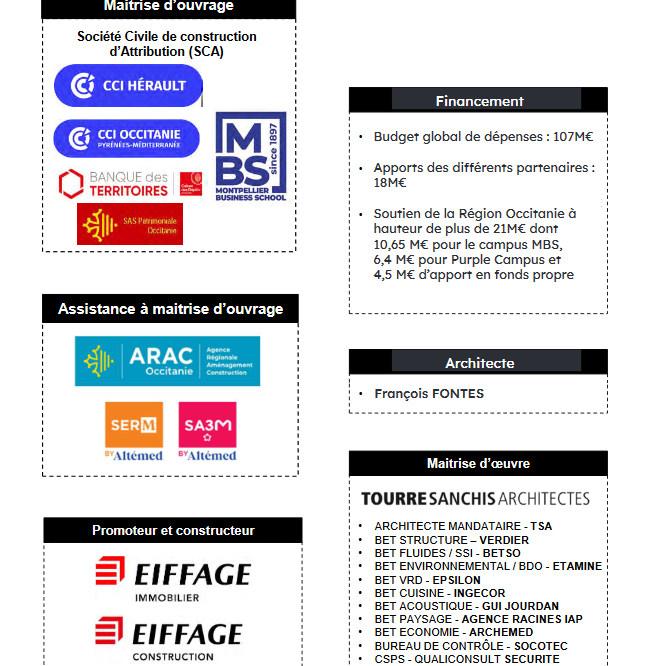Les employeurs ont la possibilité de verser aux salariés une prime dite « prime de partage de la valeur » (PPV) exonérée de cotisations et contributions sociales sous conditions. Toutes les entreprises sont-elles concernées ? Comment mettre en place ce dispositif ? On vous répond.

À savoir
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur introduit un nouveau dispositif : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Une prime de partage de la valorisation de l’entreprise est versée aux salariés, en complément de la prime de partage de la valeur, dans le cas où la valeur de l'entreprise aurait augmenté au cours des trois années suivant la date fixée par un accord collectif.
Le montant perçu par le salarié correspond à un montant de référence auquel on applique le taux de variation de l'entreprise, lorsque celui-ci est positif.
Le montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l'accord mettant en place le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Ce montant peut différer selon la rémunération du salarié, son niveau de classification ou la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
Seuls les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient de ce plan. Néanmoins, il est possible de prévoir dans l'accord une durée d'ancienneté inférieure.
Notez que cette prime peut être placée sur un plan d'épargne salariale.
Qu'est-ce que la prime de partage de la valeur ?
La prime de partage de la valeur a été instituée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat puis modifiée par la loi du 29 novembre 2023 citée précédemment.
Elle permet aux employeurs de verser une prime aux salariés une prime qui peut être exonérée d’impôt et de cotisations sociales si elle respecte certaines conditions liées à sa date de versement, son montant et la rémunération du salarié à qui elle est versée.
Ce dispositif est facultatif.
À savoir
La prime de partage de la valeur ne peut, en aucun cas, se substituer au salaire, ni à des augmentations de rémunération ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
En cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération dont il est question et la date d'effet de l'accord de participation (article 3 de la loi du 29 novembre 2023).
Quelles entreprises peuvent verser la prime de partage de la valeur ?
Le versement d’une prime de partage de la valeur peut être effectué quel que soit l'effectif salarié de l’entreprise. Plus spécifiquement, elle peut être versée par les employeurs suivants (article L3311-1 du code du travail) :
- tous les employeurs de droit privé, y compris les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions libérales), les mutuelles, les associations ou les fondations, les syndicats, etc.,
- les Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) (RATP, INA, Opéra de Paris),
- les Établissements publics administratifs (EPA) lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé (par exemple : agences régionales de santé – ARS –, France Travail, Caisses nationales de Sécurité sociale).
À savoir
La prime de partage de la valeur peut également être versée par :
- les entreprises de travail temporaire aux salariés intérimaires lorsque l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition verse une prime à ses salariés (prime versée selon les modalités fixées par l’entreprise utilisatrice),
- les établissements ou services d’aide par le travail (Esat) aux travailleurs en situation de handicap sous contrat de soutien et d’aide par le travail.
Quels salariés sont éligibles à cette prime ?
La prime de partage de la valeur peut bénéficier aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant d'un établissement public administratif ou industriel et commercial et aux travailleurs en situation de handicap liés à un Esat par un contrat de soutien et d'aide par le travail, soit :
- à la date de versement de la prime,
- à la date de dépôt de l'accord,
- ou à la date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur l’instituant.
Le montant de la prime peut être uniforme ou varier selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail.
Quels sont les plafonds d'exonération de la prime ?
Comme le précise la loi, le montant maximum d‘exonération est de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile.
Ce montant maximal peut être porté à 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile, à condition que l'employeur mette en œuvre :
- un dispositif d’intéressement lorsqu’il est soumis à l’obligation de mise en place de la participation,
- un dispositif d’intéressement ou de participation lorsqu’il n’est pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation.
Ces dispositifs doivent être mis en œuvre à la date de versement de la prime ou être conclus au titre du même exercice que celui du versement de la prime.
Notez que les structures suivantes ne sont pas soumises au respect des conditions citées ci-dessus :
- les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts)
- les Esat au titre des primes versées aux travailleurs en situation de handicap.
Intéressement et participation : quelles différences ?
- La participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Ce dispositif est obligatoire pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés.
- L’intéressement permet d’associer financièrement les salariés aux résultats ou à la performance de l’entreprise. C'est un dispositif collectif facultatif qui peut être mis en place par toutes les entreprises.
Comment fonctionne l'exonération de la prime ?
L'étendue de l’exonération de cotisations et contributions, applicable dans la limite de 3 000 euros ou 6 000 euros par bénéficiaire et par année civile, est conditionnée selon la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié.
Prime versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023
Sur cette période, la ou les primes versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sont exonérées de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.
La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.
Prime versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026
Sur cette période, la ou les primes de partage de la valeur versées par une entreprise employant moins de 50 salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sont également exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que des cotisations et contributions sociales patronales et salariales.
À savoir
Le salarié ayant adhéré à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise peut y affecter tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre des primes de partage de la valeur perçues. Là encore, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans les limites de 3 000 euros ou 6 000 euros mentionnés ci-dessus.
Vous devez informer le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d'affectation au plan d'épargne salariale ou au plan d'épargne retraite d'entreprise.
Notez que si le règlement du plan le prévoit, le versement de la prime sur un plan d’épargne salariale peut faire l’objet d’un abondement.
Comment mettre en place la prime de partage de la valeur dans l'entreprise ?
La mise en place de la prime, son montant et les éventuelles conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires, doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon l'une des modalités suivantes :
- par convention ou accord collectif de travail,
- par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
- par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE),
- par ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
La prime peut également être mise en place par décision unilatérale de l’employeur, qui consulte au préalable le comité social et économique.
Comment la prime est-elle versée ?
Deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées au titre d’une même année civile.
Le versement de la prime ou des deux primes peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre, au cours de l'année civile.
À savoir
Depuis le 1er décembre 2023 et pendant une durée de cinq ans, un dispositif obligatoire de partage de valeur est expérimenté dans certaines entreprises bénéficiaires. Il s'agit des entreprises qui réunissent les critères suivants :
- effectif compris entre 11 et 49 salariés,
- activité exercée sous la forme juridique de société,
- bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % des recettes pendant trois années consécutives.
Dans ces entreprises, le partage de valeur obligatoire peut correspondre à la signature d'un accord de participation ou d'intéressement, à l'abondement d'un plan d'épargne salariale (PEE, Perco, PER Collectif) ou au versement de la prime de partage de la valeur.
L'obligation de mettre en place un dispositif obligatoire de partage de valeur s'applique aux exercices* ouverts après le 31 décembre 2024.
* Période durant laquelle les données chiffrées d'une entreprise (activité et patrimoine) sont enregistrées. L'exercice dure en général 12 mois, alignés ou non sur l'année civile.

















 Que vous réalisiez un investissement locatif dans l’ancien ou dans le neuf, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de différents avantages fiscaux. Quels sont-ils ? Quelles conditions respecter pour en bénéficier ? Tour d’horizon des principaux dispositifs en vigueur.
Que vous réalisiez un investissement locatif dans l’ancien ou dans le neuf, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de différents avantages fiscaux. Quels sont-ils ? Quelles conditions respecter pour en bénéficier ? Tour d’horizon des principaux dispositifs en vigueur.