Il est toujours difficile, notait l'historien J. Meyer (Histoire de France, Hachette 1985, T.3), pour les créations urbanistiques, de s'insérer dans le cadre existant. Ainsi Sète, création artificielle, s'est heurtée à la concurrence de deux métropoles existantes, Bordeaux et Marseille, en cherchant à diversifier ses activités. Et, en tentant de développer une manufacture de tabac après le milieu du XVIIIè siècle, des négociants sétois échouèrent.
Les tentatives languedociennes pour diversifier et développer l'activité de Sète forment, depuis sa création (1666) jusqu'à la fin du XVIIIè siècle, une liste de déconvenues. Le regretté professeur Dermigny, sur la foi des rapports officiels, incriminait le manque d'esprit d'entreprise des Languedociens (Esquisse de l'histoire d'un port). Selon lui, "Les Languedociens entreprenants sur le plan maritime, c'est de préférence hors du Languedoc qu'on les rencontre", à Bordeaux et surtout à Marseille. La cité phocéenne veille jalousement sur le respect de son monopole du commerce avec le Levant et, par Agde, concurrence directement la création de Louis XIV. Quant à la concurrence de Bordeaux, elle fit échouer les tentatives d'établissement de lignes vers l'Amérique et les Antilles. Le milieu du XVIIIè siècle vit l'échec du raffinage du sucre. Or, l'entreprise Tinel à peine liquidée en 1750, quatre négociants sétois (Bresson, Ratyé, Mercier et Coulet frères) s'associent pour installer une manufacture de tabac dans les locaux de l'ancienne raffinerie (à peu près sur l'emplacement des halles actuelles).
Après tant d'échecs, ils manifestaient un bel esprit d'entreprise.

En 1751, le tabac arrive de Virginie par le relais de la métropole britannique, principalement par les ports de Whitehaven, Ayr et Glasgow. Et Sète va nouer des liens spirituels avec l'Amérique. Les autorités languedociennes sont en contact avec Benjamin Franklin. Les idéaux proclamés par les révoltés contre la couronne anglaise diffusent dans la bourgeoisie. A tel point qu'en 1782 est créée la loge maçonnique des Amis fidèles des Treize Etats Unis. A Sète, on avait fêté la victoire de Yorktown (1781) avec Te Deum et feu d'artifice. Victoire morale qui se doublait de l'ouverture d'un marché à l'échelle continentale.
La manufacture semble prendre son essor. Elle "occupe 300 ouvriers et fournit les bureaux de Lyon et les provinces voisines du Rhône". L'entreprise résiste à un incendie et aux plaintes des Sétois relatives aux fumées et odeurs provoquées par le brûlage des rebuts. Les lettres de protestation s'accumulent sur le bureau du maire. Par ailleurs, les ouvriers à la manufacture sont mal payés : un ouvrier ne gagne que 18 sous (une bonne journée de travail est payée 1 livre, soit 20 sous). Les autres employés (femmes, enfants) encore moins. Mais des difficultés apparaissent dans l'écoulement des produits. L'entreprise a 100 000 tonnes en stock.
Et, à Marseille, on sature le marché, on casse les prix. La ligue du tabac décline, de même que l'activité de la manufacture. Peu à peu, elle cesse ses activités. Ses locaux ont été transformés en caserne en 1795.
Hervé Le Blanche


















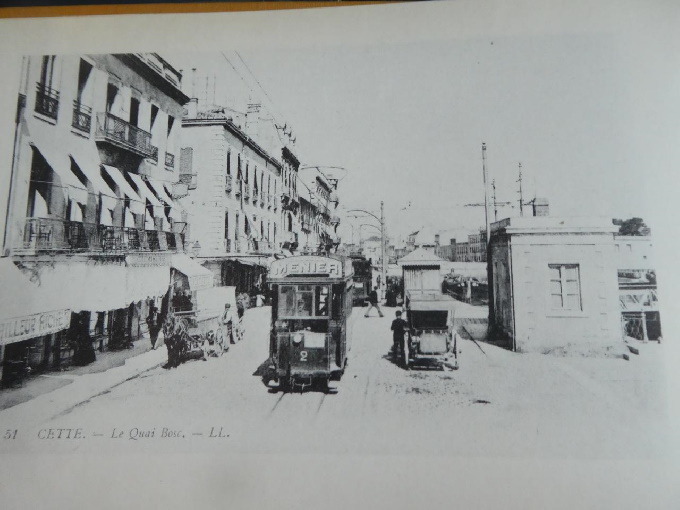


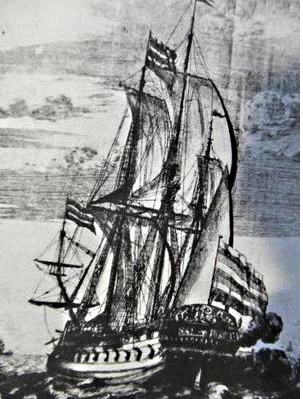



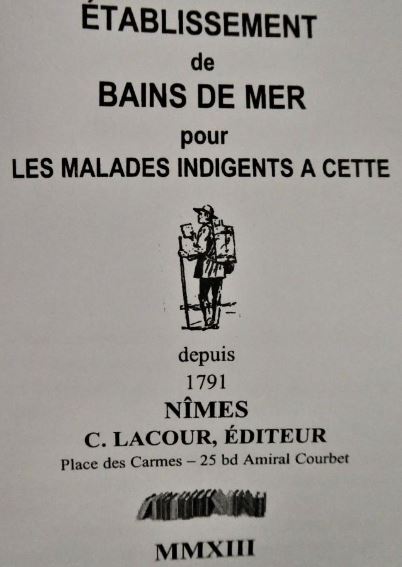 J.C. Gaussent (BSESS XIX-X 1986) situe l'apogée de la communauté protestante pour le XIXè siècle de 1866 à 1885. En nombre, elle est passée depuis 1802 de 780 à 2 300 personnes. Outre le groupe des marchands-négociants, elle recrute dans les milieux populaires (tonneliers) et, le port diversifiant ses activités, "vers 1870, les employés du gaz ou du chemin de fer comptent autant que les tonneliers". G. Frisch est courtier maritime, Julien père et fils raffinent le soufre et "le fils du pasteur Cazelles fait le commerce du bois". Mais le domaine de la pêche et de l'armement restent étrangers à la communauté réformée. Il fallut subventions et souscriptions pour reconstruire le temple qui datait de 1832. Quand tous les comptes furent apurés, lors de l'inauguration du 1er août 1878, une douzaine de pasteurs refusent de se joindre à leurs collègues, arguant du devoir de leur charge ou de la chaleur estivale. Ces refus sont le fait de divergences théologiques. Face aux Evangéliques dogmatiques, diffuse, depuis Sète, une doctrine plus "libérale" qui touche Nîmes, Montpellier, Le Vigan. Au total, 400 personnes, dont une centaine à Sète.
J.C. Gaussent (BSESS XIX-X 1986) situe l'apogée de la communauté protestante pour le XIXè siècle de 1866 à 1885. En nombre, elle est passée depuis 1802 de 780 à 2 300 personnes. Outre le groupe des marchands-négociants, elle recrute dans les milieux populaires (tonneliers) et, le port diversifiant ses activités, "vers 1870, les employés du gaz ou du chemin de fer comptent autant que les tonneliers". G. Frisch est courtier maritime, Julien père et fils raffinent le soufre et "le fils du pasteur Cazelles fait le commerce du bois". Mais le domaine de la pêche et de l'armement restent étrangers à la communauté réformée. Il fallut subventions et souscriptions pour reconstruire le temple qui datait de 1832. Quand tous les comptes furent apurés, lors de l'inauguration du 1er août 1878, une douzaine de pasteurs refusent de se joindre à leurs collègues, arguant du devoir de leur charge ou de la chaleur estivale. Ces refus sont le fait de divergences théologiques. Face aux Evangéliques dogmatiques, diffuse, depuis Sète, une doctrine plus "libérale" qui touche Nîmes, Montpellier, Le Vigan. Au total, 400 personnes, dont une centaine à Sète.